
Théologien·ne
| Mise à jour 17/07/2012 |
Selon la définition classique, la théologie est une étude de la foi qui cherche à se comprendre elle-même et à se dire. Le théologien cherche donc à connaître et à étudier la foi, à partir des textes sacrés et de la tradition où elle est enracinée, pour mieux l’ouvrir aux défis d’une culture en perpétuelle mutation. Il réfléchit au pourquoi de l'existence, à l'origine de l'homme et à sa destinée. Il cherche à comprendre Dieu et le monde en faisant appel à toutes les ressources qu’offre la raison. D’où le recours à la philosophie, aux sciences humaines, sciences naturelles, à la culture, etc. Loin de se définir comme un discours replié sur lui-même et frileux à tout contact autre que le sien, le langage de la théologie est indissociable d’un rapport à tout ce qui définit l’être humain. La croyance ou le refus de cette croyance inspire des comportements, des discours, des écritures qui sont de beaux objets d'étude ! Certes, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà la foi chevillée au corps pour entreprendre des études de théologie, mais faut pouvoir prendre au sérieux les questions qu’elle pose et les réponses qu’elle apporte. Il faut aussi accepter de confronter la foi aux questionnements dont elle est l’objet. Exposer la foi à la critique de la raison, c’est aussi une manière de la structurer et de la faire mûrir.
La théologie chrétienne comporte trois axes principaux, articulés l’un à l’autre. D’abord un axe biblique et historique : l’étude de la Bible (Ancien et Nouveau Testament), des écrits des grands théologiens et de l’histoire du Christianisme. Ensuite, l’effort réflexif qui consiste à rendre compte de l’intelligibilité de la foi. Le troisième axe a pour objet les pratiques individuelles ou collectives des croyants.
La théologie chrétienne ne s'arrête pas qu'au Christianisme, car une connaissance de la tradition chrétienne ne suffit plus à comprendre les grands débats du monde moderne. Le théologien s'efforce de fournir les connaissances nécessaires au dialogue entre les grandes religions.
« Il faut bien comprendre que la théologie n'est pas la même chose que la prêtrise. »
Mr Jean-Marie Auwers, Vice-doyen de la Faculté de Théologie Lire l'interview
Compétences & actions
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Capacité à approcher les textes des traditions biblique et chrétienne en grec ou en latin
- Pouvoir initier une réflexion éthique et dogmatique
- Pouvoir décoder et comprendre les discours et phénomènes religieux
- Maîtrise de l'histoire du Christianisme, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament
Savoir-être
- Intérêt pour les questions humaines et religieuses
- Excellente écoute
- Sens du dialogue
- Tolérance, ouverture d'esprit
- Esprit critique
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Rigueur
Cadre professionnel
Les études dans une Faculté de théologie offrent des débouchés divers. À côté des "classiques" que sont l’enseignement de la religion (mais aussi de la philosophie et du latin) et la recherche en théologie, plusieurs anciens ont trouvé du travail dans les services d’aumônerie (hôpital, prison) et dans l’animation pastorale (mouvements, paroisses), mais aussi par exemple dans le monde des médias, les bibliothèques, l’animation culturelle, etc. Certains théologiens ont trouvé un emploi dans le journalisme religieux et historique, dans des métiers du livre (librairie, édition) ou encore dans des métiers gravitant autour de l'art (conservateur de musée, etc.). Les qualités humaines des théologiens sont très appréciées dans l'accompagnement humain et spirituel de communautés chrétiennes, de jeunes, de malades, de personnes handicapées, de prisonniers ou de toute autre personne en difficulté. Le master en Sciences des religions, offre plus spécifiquement des perspectives du côté de
la médiation interculturelle et interreligieuse.
8 commentaires
 -
Il y a 1 mois
-
Il y a 1 mois
Bonjour Ismaël,
Pour entamer des études universitaires en Sciences religieuses, il est attendu de l’étudiant·e qu’il ou elle possède une bonne maîtrise du français parlé et écrit, un esprit d’analyse et de synthèse, une certaine ouverture d’esprit et un intérêt pour les questions humaines et religieuses.
La formation sera axée sur les sciences humaines (anthropologie, psychologie, philosophie,…) et sur la théologie et les sciences des religions (exégèse biblique, réflexion éthique et dogmatique, théologie pratique, ainsi que l'histoire du christianisme et les sciences des religions). Le programme comporte également des cours d’anglais et une initiation aux langues anciennes (grec biblique, latin, hébreu).
Il n’existe pas de cours préparatoires en tant que tel dans ce domaine d’étude. Un intérêt personnel, qui peut se traduire de différentes manières (lectures personnelles, documentaires,…) est déjà un bon point de départ. À vous de voir aussi si vous devez envisager une remise à niveau en anglais (ou l’apprentissage de cette langue), si votre maitrise du française est suffisante et si elle nécessite également une remise à niveau, etc.
N’hésitez pas à prendre connaissance du programme de cours et à contacter les établissements qui organisent des bacheliers et/ou masters dans ce domaine. Vous trouverez leurs coordonnées en suivant les liens proposés dans la partie "Formations recommandées" au bas de cette fiche descriptive.
Bonne journée.
c’est très bien expliquer c’est super je suis théologienne et c’est franchement bien expliquer d’ailleurs si vous avez des questions n hésitez pas ! bonne soirée!!
 -
Il y a 1 an
-
Il y a 1 an
Bonjour Julie, Merci pour vos encouragements. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos visiteurs.
Bonjour Julie, je suis lycéenne mais j'ai énormément de question concernant ce métier, auriez vous un email ou autre afin que l'on puisse discuter ?
 -
Il y a 1 an
-
Il y a 1 an
Bonjour Cassy,
Pour éviter que Julie ne donne ses informations privées (son mail) sur un site public, il vaut mieux poser toutes vos questions ici pour qu'elle puisse y répondre. De plus, ses réponses pourraient probablement intéresser d'autres visiteurs de notre site.
Merci.
Bonne journée.
Bonjour Julie.
Sans emploi, j'étudie les textes religieux par passion et fascination, et je les trouve tellement intéressants. Je me pose la question si je devrais essayer de devenir théologiens. Auriez-vous des conseils à me donner pour y parvenir, ou si c'est un projet qui en vaut la peine ?
 -
Il y a 2 mois
-
Il y a 2 mois
Bonjour Adam,
Pour devenir théologien, une formation académique est essentielle. Nous vous conseillons de regarder les programmes universitaires en théologie, études religieuses ou sciences bibliques et de vous adresser aux facultés proposant ces filières pour avoir de plus amples informations sur les différents programmes de cours et leur contenu. Vous trouverez les coordonnées des facultés en suivant les liens proposés dans la partie "Formations recommandées" au bas de cette fiche descriptive.



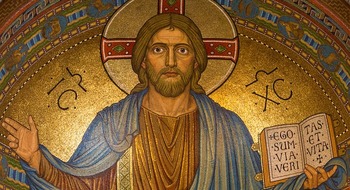


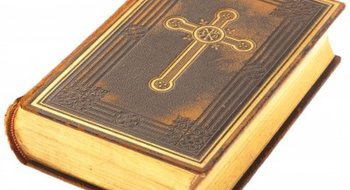
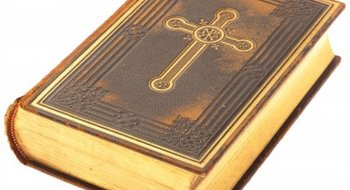






Bonjour Madame,
J’aimerais débuter dans la théologie, mais je ne sais pas par où commencé.
Actuellement je poursuit mes études en secondaire, il me reste une année pour avoir mon diplôme en tant qu’éducateur.
Je n’ai aucune base et aucune connaissance solide pour pouvoir être théologien ou pour poursuivre des études supérieur dans cette branche.
Pour ce fait, j’aimerais cette année prendre de l’avance pour que je sois préparé un minimum lorsque j’irais en université.
Connaissez-vous des cours du soir ou des sites dans les quelles je pourrais m’instruire et prendre de l’avance ?